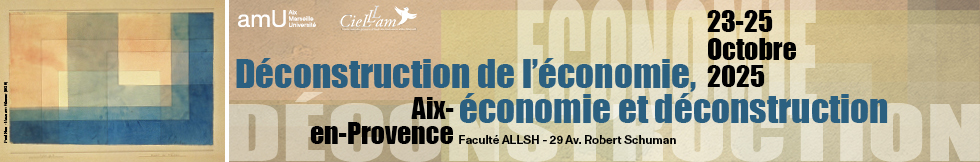
PROGRAMME > Résumés des interventionsSESSION 1 Nadja GERNALZICK Deconstruction, Grammatology, and Monetary Economics Revisited: From Economy as Metaphor of System to Money as Exemplary Signifier
Thibault MERCIER « La différance est le concept de l’économie »
SESSION 2 Giuseppe LONGO Les méthodes d'optimum dans les sciences historiques : un geste théologico-politique
Francesco VITALE Métaphores de la loi et l'économie entre sciences de la nature et sciences sociales
SESSION 3 Patrick MARDELLAT Critique du taux d’intérêt. Prolégomène à la déconstruction de l’économie politique Le postulat de l’économie politique (=théorie du capitalisme) est la rareté contre laquelle il convient de lutter. La croissance économique est supposée offrir le salut contre ce malheur du manque, dont la pauvreté est le signe. La production n’est possible qu’avec une « avance » (François Quesnay) qui doit être récupérée à la fin du cycle, et même augmentée pour permettre de croitre. Or, cette avance se fait en monnaie par les banques dans le crédit, sous le contrôle de l’État par l’intermédiaire de la banque centrale. L’accès à la monnaie se fait moyennant un taux d’intérêt prélevé sur le capital emprunté, qui oblige à produire plus en vue d’en assurer le financement. Mais quelle est la justification économique de ce tribut ? L’analyse néoclassique (I. Fisher) assure qu’il s’agit du prix du temps, au cours duquel l’argent est en possession de l’emprunteur et dont le prêteur est privé. Cette explication est devenue la vulgate des économistes. Or, cette justification ne tient pas. Aristote est le premier à avoir contesté la légitimité du taux d’intérêt, qu’il estimait haïssable avec le plus de raison. Marx lui a emboîté le pas. En quoi le taux d’intérêt est-il contraire à la raison ? En quoi est-il déraisonnable ? Il convient de faire retour sur la nature de sa monnaie, la logique de sa création dans le crédit, afin de déconstruire la bancocratie qui nous gouverne et nous mène au gouffre. La critique du taux d’intérêt est le prolégomène à toute déconstruction de l’économie politique, donc du capitalisme.
Giustino DE MICHELE Déconstruction de la déconstruction de la valeur-substance
SESSION 4 Francesca MANZARI Liaisons, échanges, quantités. Autour de l'Au-delà du principe de plaisir
Alain DENEAULT Ôter l'économie aux économistes. Histoire d'un rapt sémantique. Alors que Xénophon et Aristote n'osaient pas même traiter d'économie comme telle, préférant substantiver l'adjectif économique, au XVIIIe siècle, les conseillers de Louis XV, appelés à être désignés comme physiocrates par la postérité, se présentèrent eux-mêmes comme économistes et firent progressivement de l'économie leur chose propre. Ils ont ainsi contribué à occulter la polysémie d'un terme qui, jusqu'alors, participait à toutes les disciplines, des arts aux sciences en passant par la politique.
SESSION 5 Ludovic DESMEDT Derrida et les coupures monétaires On sait l’intérêt que Derrida portait au poème de Baudelaire « La fausse monnaie » puisqu’il y consacra un ouvrage entier paru en 1991 (Donner le temps). Dans ce texte, il s’interrogeait sur le don et examinait la distinction entre vraies et fausses espèces. La question monétaire est également très présente dans d’autres œuvres du philosophe, notamment dans La carte postale (1980). Pour Derrida, la monnaie est avant tout une inscription, une écriture qui circule. En ceci, le billet de banque se rapproche de la carte postale, tous deux porteurs d’images et de textes lisibles par tous. En revenant sur ces textes et d’autres nous tenterons de préciser la spécificité du discours du philosophe (« La description critique de l'argent est la réflexion fidèle du discours sur l'écriture. », De la grammatologie, p.424) et les liens éventuels qu’il entretient avec l’approche d’économistes institutionnalistes (Aglietta, Orléan, Théret, Servet…).
Anne-Laure DELATTE A-t-on besoin de la recherche en économie pour une bonne démocratie?
SESSION 6 Anne ALOMBERT Lire Marx après Derrida : la nouvelle critique de l'économie politique de Bernard Stiegler
Solange MANCHE The Politics of Post-Deconstruction: Finance and the Milieu In Le Change Heidegger, Malabou writes: “l’échangabilité absolue est la structure.” This statement is later picked up by Alexander Galloway who interprets it as an indication that Malabou’s notion of plasticity is “too intimately related to the mode of production” (2010). Malabou’s notion of the motor scheme (le schème moteur) and the interplay between positive and negative plasticity, however, contradict Galloway’s reading: absolute exchangeability, or what she refers to as ontological capitalism, is historical through and through and is already overcome by the plasticity of the plasticity of the concept. Catherine Malabou, Bernard Stiegler, François Laruelle and Quentin Meillassoux are identified by both Galloway and Ian James to mark a turn in French philosophy, introducing a post-deconstructive moment that refocuses on the real and the material, and engages in an effort to build a bridge with the natural sciences. In this paper, I seek to identify what the shift from deconstruction to post-deconstruction means, politically. Building on regulation theory and heterodox financialisation economics (Lapavitsas, Braun, Gabor), I argue that the overcoming of the overlap between the motor scheme of writing with the experience of postmodernity is the outcome of the increased financialisation of the milieu. Whereas the fluidity of early finance capital was perhaps more reminiscent of deferral, the abstraction of speculation now makes its disruptive return to the material.
SESSION 7 Isabelle ALFANDRY Économie pulsionnelle: la question de l’au-delà. Dans cette présentation, je souhaite aborder la manière dont Derrida relit et remanie la théorie des pulsions de Freud. La question de la pulsion de mort pose la question de l’au-delà du principe de plaisir. Cette question est de nature économique, d’une économique qui implique un départ, un débord, un dérèglement et oblige à repenser le dualisme pulsionnel autrement.
Jan Horst KEPPLER (Université Paris Dauphine-PSL) Métaphore, icône, spectre : économie de marché et inconscient En 1966, Jacques Derrida présente la déconstruction comme un mode d’interprétation qui ne vise plus à restituer la vérité ou l’origine d’un texte, mais s’adonne au jeu de l’intertextualité. Au lieu de traquer une métaphore unique et irremplaçable, fût-elle dissimulée, la déconstruction cherche l’entendement — et une jouissance herméneutique — dans le suivi de déplacements métonymiques entre textes, impulsées par des signifiants singuliers. Appliquer cette démarche interprétative à l’économie de marché est foncièrement ambivalent. Telle la déconstruction, l’économie de marché, comme ses représentations théoriques, dénie la pertinence d’un signifiant unique et durable qui polariserait stratégies discursives et conduites. À cette métaphore supposée, le marché substitue une succession aléatoire d’icônes marchandes, engendrées par un mimétisme récursif (« j’aime ce que vous aimez », etc.). La déconstruction de quelque métaphore économique subsistante risquerait alors de doubler l’opération propre du marché, au lieu de s’attaquer au mouvement même du défilement des attracteurs partiels, éphémères, discontinus et non-transitifs qui en constitue l’essence. Heureusement, une déconstruction plus libre ne se détourne pas du mouvement spécifique par lequel la constitution, l’étalage, l’échange et l’usage des icônes marchandes produisent invariablement un reste – un résidu, un surplus libidinal non résorbé, une pulsion de répétition, un symptôme. Derrida en déploie les linéaments dans Donner le temps et Spectres de Marx ainsi que, plus indirectement, dans d’autres écrits. Ces textes gravitent, chacun à sa manière, autour de ce reste — de temps (Mauss), de véracité (Baudelaire), de plus‑value (Marx), d’énergie pulsionnelle (Bataille), de valeur esthétique (Kant), de reconnaissance (l’université) — engendré par l’échange marchand, nécessairement monétaire. Ils entrent alors en dialogue étroit avec les élaborations redevables à Smith, Marx, Freud, Lévi-Strauss, Lacan et Baudrillard développées dans Economie de marché : la pulsion à l’origine de la valeur (Classiques Garnier, 2024). La double perspective sémiotique et psychanalytique permet ici à établir que la production d’un tel reste est inhérente à l’attrait économique de la marchandise. Seules son isolation syntaxique et son érection en icône déclenchent l’investissement pulsionnel qui génère une valeur d’échange dépassant le coût de production et la plus-value. Ayant évité le risque de préparer le terrain à la marchandisation, la déconstruction derridienne devient alors un complément indispensable : caractériser les facettes du reste produit en économie de marché, démêler les leurres qui lui sont associés, en atténuer – par des mots justes – les symptômes les plus aigus, et reconnaître sa virulence irrépressible.
SESSION 8 Simon Morgan WORTHAM Looking for noon at two o’clock: economy, retroactivity, debt Derrida’s Given Time opens with an epigraph taken from a letter written by Madame de Maintenon, the morganatic wife of Louis XIV and founder of the Maison royale de Saint-Louis, which reads: “The King takes all my time; I give the rest to Saint-Cyr, to whom I would like to give all.” This is obviously a wry citation. While Louis’ sovereignty as both a king and a husband is expressed through an unqualified demand which seems to reverse the regal gift (the King taking rather than giving everything) only to confirm its sovereignty all the more powerfully, Louis’ royal spouse also owes a religious duty or debt that is willingly conceded despite—and perhaps because of—its incalculable relation to the sovereign absolute. There is simply more time than is possible in the temporal equation which sees Madame de Maintenon giving an impossible remainder to the one she feels she owes everything (Saint-Cyr), even though everything is already expended in her obligations to the King. The double sovereignty of monarch and God, the amplifying reflection of temporal and spiritual power, is subject to droll reformulation and felicitous reinforcement at one and the same time. But the real point Derrida wants to make by beginning with this allusion is that it is time which the gift gives. The (sovereign) time that may be given to or by a king or a god is not subject to economic calculation, or to the normative mathematics of exchange, although, as we shall see, such “time” also challenges sovereignty itself. It is, therefore, somewhat ironic that Maintenon chimes with maintenant, the French word for “now” or “presently,” since the gifts of Madame de Maintenon do not form a self-identical present; indeed, their special character is that they do not amount to one and the same thing (the “time” owed to Saint-Cyr is neither the same as itself nor equivalent to the “time” of the King). This non-self-identity—a powerfully enabling difference as much as a limiting contradiction—is the peculiar facet or feature of a “time” that is at once impossibly divided and redoubled. Time, of course, belongs to no one, as Derrida points out, and can no more be given than taken; but, as such, it “begins to appear as that which undoes this distinction between taking and giving” that sets in motion the very idea of economy or exchange. The remainder of time is not, therefore, a remaining time that can be calculated as such (e.g., the seemingly impossible time left for Saint-Cyr once the unqualified time owed to the King has elapsed). It is not an apportionable time, a “part” of time as itself a reckonable whole. Instead, it is that non-present remainder which persists in confounding the economy that continually seeks to co-opt it—a “part” which therefore grows incalculably larger, in a certain sense, than the economic “whole” that it both funds and forestalls. For Derrida, such “time” is not some “other-worldly” abstract entity outside of the “this-worldly” concrete sphere of exchange; instead, it affirms the deconstructible and perhaps duplicitous limits of what might be termed the economy of “presence.” Looking for the gift-without-present is, therefore, like looking for noon at two o’clock, to use the French saying cited by Derrida. As this phrase from Baudelaire’s “Counterfeit Money” suggests, the search for the gift is always belated or retrospective, locating it in a non-present that will have already eluded us; although, in another sense, the gift is that impossible possibility which remains to come, in and of a future that cannot be projected from the present. Such impossible possibility, let us recall, unseats mastery itself, so that ultimately the gift can no more be co-opted by sovereign forms of power than by the economic marketplace. But what the gift therefore does, in its relationship to time and exchange, is to impel the retroactivity of all economies—stirring a tendency to search out that non-present supplement to the “here-and-now” cycle of readily transactable values, and to provide a subsidiary account of their supposedly self-evident (and thus already balanced) accounting. Derrida’s reading of the gift/time in its relationship to economy and exchange, in other words, opens a critical pathway onto the question of retroactive debt—an unsettled account that comes back to us, however impossibly, as much from the future as the past. In what follows, I want to draw on Derrida’s analysis of the gift and time in order to demonstrate how this question of retroactivity both constructs and deconstructs recent analyses of debt, especially in the wake of recent global financial crises. Against the criticism that deconstruction is itself prone to a melancholic indebted ness that is alleged to induce a certain paralysis, I argue that it also offers the tools for a more fundamental excavation of the retroactivity which surreptitiously funds these critical accounts of debt even as they seek to uncover and expose its importance.
Peter SZENDY Don, dette, récit En lisant de près des passages choisis du séminaire Donner le temps, on tentera de comprendre les effets de la superposition qui s’y joue entre, d’une part, la structure du don ou de la dette (un donateur ou débiteur face à un donataire ou créditeur) et, d’autre part, la structure du récit (un narrateur qui raconte pour un narrataire). La triangulation des relations d’endettement qui en résulte pourrait bien — telle est l’hypothèse — s’avérer fondamentale pour une pensée de la dette préoccupée par son abolition.
SESSION 9 Carlo VERCELLONE Le capitalisme de plateforme et le débat autour du Free Digital Labour. Une analyse critique
Luca PALTRINIERI L'illimité : Malthus contra Condorcet (de l'économie restreinte à l'économie générale) Premier titulaire d’une chaire d’économie politique en Angleterre, Malthus aurait fait de l’économie une dismal science, selon la célèbre définition de Carlyle. À l’optimisme progressiste et révolutionnaire des Lumières – représenté par Condorcet –, il aurait opposé des limites naturelles indépassables, issues de la célèbre contradiction entre la croissance démographique et les ressources. Cette image lui valut un soupçon durable dans les milieux économiques (à l’exception notable de Keynes), une condamnation sans appel de Marx, ainsi qu’une longue postérité en écologie politique. Or, au sein même de l’écologie politique, une seconde interprétation est apparue, renouant avec la critique marxiste tout en faisant de Malthus le prophète d’une croissance virtuellement illimitée. Dans cette intervention, je voudrais montrer que ces deux lectures, bien qu’inexactes, contiennent chacune une part de vérité : d’une part, Malthus mobilise contre l’idée de croissance infinie une « économie de la nature » d’inspiration smithienne ; d’autre part, il conçoit la croissance comme une expansion franchissant des seuils et différant indéfiniment le choc de la population au plafond des subsistances. C’est en mobilisant certains outils de la déconstruction, en particulier à partir des travaux de Derrida et d’Egidius Berns, que je voudrais décrire cette structure malthusienne paradoxale de la limite-seuil, afin d’y déceler une dimension proprement temporelle du capitalisme : un système dont l’aboutissement est la catastrophe, mais où tout se passe comme si cette catastrophe était sans cesse différée, retardée, suspendue par un Katechon économique.
SESSION 10 Bertrand OGILVIE De quoi fait-on l’économie avec la notion d’économie ?
Apostolos LAMPROPOULOS (Université Bordeaux Montaigne) Faire l’économie de ses mots Dans Politique et amitié, un livre d’entretiens avec Michael Sprinker menés au début des années 1990, Jacques Derrida revient sur ce qu’il se sentait obligé de dissimuler ou se disait incapable d’énoncer à propos du marxisme pendant les toutes premières années de sa carrière, notamment dans des contextes institutionnels très politisés. Dans ses séminaires sur l’hospitalité, donnés en 1995-1997 et publiés en 2021-2022, on découvre des positions qui, absentes de ses tapuscrits, ont été exprimées sous forme d’interventions orales enregistrées et ne sont communiquées à un public excédant celui des séminaires que plusieurs décennies plus tard. Dans ces séances, Derrida pose souvent des questions qui restent sans réponse et qui pouvaient heurter son auditoire ; son idée d’une hospitalité offerte au virus du VIH/sida, exprimée en pleine pandémie, en constitue peut-être l’exemple le plus caractéristique. De son côté, Anne Berger (“Topolitics of the Safe Space”, 2023) propose une réflexion féconde sur la notion de safe space par rapport à celle de l’Université sans condition avancée par Derrida, et, par là, sur ce qui serait un aménagement de la parole vis-à-vis de l’idéal démocratique de l’institution universitaire. Enfin, Sam Bourcier, dans son récent ouvrage Le pouls de l’archive, c’est en nous qu’il bat (2025), dialogue avec la réflexion de Derrida/Dididada et se situe entre ce qu’il comprend comme l’hypomnésie de l’écriture et l’hypermnésie de la conception historienne de l’archive, nous appelant à laisser l’oreille et le toucher y prendre toute leur place. En s’appuyant sur ces références, cette communication propose une réflexion sur ce que pourrait être une économie des mots dans les contextes institutionnels.
SESSION 11 Marie CUILLERAI Du temps volé
Simon GLENDINNING Here the money, there the cow you can buy with it: Money ideas in Deconstruction This talk examines Wittgenstein’s monetary analogy in Philosophical Investigations §120, challenging Terry Eagleton’s Marxist reading that accuses Wittgenstein of economic naivety in treating money as equivalent to words through “use”. Drawing on Piero Sraffa’s critique of neoclassical marginalism and his insistence that “all our utilities are derived from social conventions”, it is argued that Wittgenstein’s monetary analogy should be understood in Sraffian terms. The ‘utility’ of money should be understood in terms of it providing a socially conventional standard of value that stabilizes qualitative use-value identities in a quantitative way, making exchange-value internal to use-value from the start, the former haunting the latter. Far from obscuring social reality through a false equivalence, Wittgenstein’s money remark invites consideration of how exchange-values structure the relational field of all our utilities in a social world. The talk concludes that money’s “divided virtue” lies in its capacity for use-value-specification within a general structure of use-value-indifference, making the very identity of any commodity inseparable from the possibility of exchange. |

